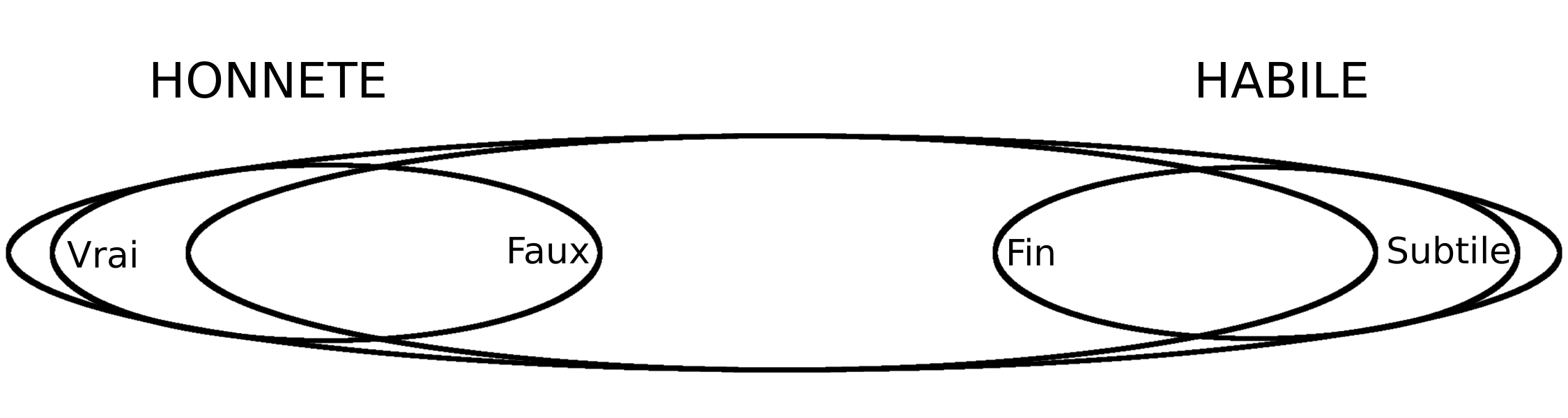Je me propose dans cet essai de faire voir comment le héros de L’Orphelin infortuné ou le portrait du bon frère, petit roman d’à peu près 150 pages dans l’édition de 1991, réussit à survivre dans des conditions physiquement et socialement déplorables, tout en maintenant sa propre intégrité morale.
Paru à Paris pour la première fois chez Cardin Besogne en 1660 et republié en 1662 sous le titre Les Aventures[1] tragi-comiques du chevalier de la Gaillardise, le roman présente les aventures —ou plutôt les avanies—d’un jeune garçon, orphelin de bonne heure, en butte à toutes sortes de mauvais traitements de la part de son tuteur et de sa parenté, lesquels font preuve, non seulement d’une méchanceté qui ne se relâche jamais, mais même d’une cruauté allant jusqu’au sadisme. Forcé de fréquenter la lie de la société et souvent tenaillé par la faim et la misère, il sera contraint de vivre d’expédients simplement pour ne pas mourir de faim. Le héros (dont le nom ne sera jamais révélé) réussira à maintenir son intégrité morale —et sa bonne humeur— en dépit des souffrances qui lui sont infligées par des personnages qui sont autant d’exemples de corruption morale. Ses malheurs continueront jusqu’à son entrée dans l’âge adulte et à son établissement au service d’un gentilhomme parisien. Bien qu’il fasse quelques voyages en France, en Hollande et en Allemagne, le cadre principal de l’action est le Paris du temps de Louis XIII, grosso modo entre les années 1620 et 1640[2]. L’extrême malpropreté qui règne dans ce cadre, autant à l’extérieur (rues, places) qu’à l’intérieur (maisons, appartements), non seulement crée une dystopie qui contribue à accentuer ce contraste entre le héros et son environnement, mais renforce puissamment le réalisme de l’ouvrage. J’en parlerai en quelque détail plus loin, en m’appuyant sur des sources historiques, qui viennent soutenir et expliciter les sources littéraires.
Il importe de se pencher sur la nature littéraire de ce texte à la fois peu connu et peu conventionnel. Dernière histoire comique jamais publiée, l’ouvrage est peut-être aussi la plus réaliste et la plus picaresque du genre. César-François Oudin de Préfontaine, l’auteur de ce roman (qui n’a vraisemblablement rien d’autobiographique), est assez obscur. La notice du Dictionnaire des Lettres françaises —XVIIe siècle[3] donne une liste de ses ouvrages mais ses dates sont inconnues. Le catalogue général de la BnF présente également une douzaine de ses titres. Pas trace de lui cependant dans la Biographie universelle, ancienne et moderne (q.v.). Révisée par Emmanuel Bury et Jean Serroy, la notice du Dictionnaire des Lettres françaises —XVIIe siècle (originellement de René Bray) est assez peu flatteuse : elle le décrit comme un « romancier, linguiste et lexicographe d’assez mauvaise vie. » (1008). Citant Lacroix (peut-être Paul Lacroix — 1806–1884)[4], Bray ajoute cependant : « il avait beaucoup d’instruction ; il connaissait les langues et les littératures étrangères, il écrivait en français comme un vrai Gaulois (sic). » On note que sa période d’activité se situe en gros entre 1628 (La Diane des bois —Rouen) et les années 1670.
Pour J. Serroy, la nature picaresque de L’Orphelin infortuné ne fait pas de doute[5]. Sans effectuer une comparaison point par point, dans sa thèse Roman et Réalité, les histoires comiques au XVIIe siècle (q.v.), avec le prototype du roman picaresque, La Vida de Lazarillo de Tormes[6] (548–558), il évoque suffisamment de correspondances pour persuader son lecteur.
Parmi celles-ci [les références littéraires de L’Orphelin infortuné], la plus manifeste est celle du roman picaresque. Sur le modèle espagnol, en adoptant comme lui la forme autobiographique du récit, Préfontaine raconte les aventures d’un malheureux, ballotté par la fortune et soumis aux pires vexations par son entourage[7]. Bien qu’il ne soit pas gueux de naissance, son père étant « un grand homme de lettres» (L’Orphelin infortuné 1[8]), le héros, se retrouvant très tôt orphelin, doit apprendre à ruser pour vivre ; confié à la garde de frères et de sœurs hostiles, il ne peut que compter sur lui-même. Passant de maître en maître, il fait vite l’expérience du malheur et se trouve réduit, comme le picaro, à prendre la fortune comme elle vient, en essayant simplement, à force de fatalisme et de débrouillardise, de rendre sa vie supportable (548–549).
Serroy souligne que, comme dans Lazarillo de Tormes, l’orphelin est en permanence aux prises avec la faim et doit avoir recours à toutes sortes d’expédients simplement pour pouvoir se mettre quelque chose sous la dent[9]. Notons cependant que, comme le font bon nombre de critiques français dès qu’il s’agit de picaresque dans la littérature française, il prend soin de démarquer L’Orphelin infortuné du roman picaresque espagnol, précisant que, en dépit des conditions pénibles qu’il doit endurer, le héros n’est pas un gueux (supra), à l’instar de Lazarillo ou, plus tard, de Guzmán d’Alfarache, le héros du roman éponyme[10]de Mateo Alemán. L’orphelin se dit le fils d’un « grand homme de lettres »[11], ce qui, selon Serroy, le rattache à la bourgeoisie (548–549). Il faut constater toutefois que ce lien avec la bourgeoisie —et les milieux intellectuels— est extrêmement ténu et n’intervient pratiquement jamais dans l’existence du héros, laquelle demeure très peu éloignée de celle d’un gueux.
Dès le premier chapitre, l’orphelin expose son statut de victime perpétuelle, statut dont il n’arrivera à se libérer qu’à la fin du roman. Notons cependant que, loin d’adopter un ton pathétique, l’auteur préfère le mode enjoué, témoin l’incipit du roman :
Mon père fut un grand homme de lettres : non de ceux qui les portent pour les messagers, mais que la science rend illustres et dont la mémoire ne mourra jamais parmi ceux qui comme lui, auront l’honneur de s’attirer cette dignité par leurs mérites (1).
Précisons que l’identité de ce « grand homme de lettres » ne sera jamais dévoilée, non plus que la mention à sa mort d’une quelconque bibliothèque ou d’un fonds érudit, pour affirmer sa profession. Le frontispice de l’édition originelle (1660) porte ce sous-titre « histoire comique et véritable[12] de ce temps ». L’ouvrage se réclame donc bien de cette veine réaliste de la première moitié du XVIIe siècle. Serroy consacre toute une section de sa thèse à ce qu’il appelle « le roman vrai » (271-285). Sans se référer à L’Orphelin infortuné, il précise que ce qu’un auteur comme André Mareschal[13], par exemple, entend comme la vérité, c’est le fait de traiter la fiction sur le même plan que celle-ci. En restant étroitement focalisé sur des événements et des personnages non seulement réalistes mais carrément terre-à-terre, Préfontaine se conforme précisément à cette notion, légitimant ainsi son sous-titre rhématique[14].
L’auteur établit très vite le cadre du récit, dans ce Paris de Louis XIII lequel, loin d’être un locus amoenus lui est, dès son jeune âge, un lieu de tourments et de misère :
Je pris naissance en Paris, la capitale des Gaules et ma vie, à ce que j’ai ouï dire plusieurs fois, étant lors trop jeune pour me souvenir de cet article, commença à être traversée par le changement de quatorze nourrices, dont trois tachées de ce mal que les Napolitains appellent mal français et quatre ou cinq fort adonnées à la liqueur bachique […] Étant donc hors des mains de la dernière et échappé plusieurs fois de celles de la mort, je ne sais comment, avec les soins de ma mère et le bon air des champs où elle me fit porter […] j’atteignis l’âge de cinq ans. (7–8)
Sa mère meurt bientôt, suivie de près dans la tombe par son père. A la mort de celui-ci, il est confié (vers l’âge de sept ans) à sa demi-sœur aînée, qui se révèle, avec son mari, d’une nature monstrueuse, poursuivant l’enfant d’une haine implacable. On reçoit de la part du héros-narrateur au chapitre II (11–12) une explication lucide et fort détaillée des traitements à lui infligés : les enfants d’un second mariage sont toujours traités avec hostilité par ceux du premier. A noter qu’il ne montre aucune amertume en exposant cette situation, mais fait preuve d’un détachement presque clinique, qui contribue à renforcer l’aspect picaresque du roman.
Sa vie n’est qu’une série de mauvais traitements, suivis d’un mariage malheureux et de tentatives ruineuses dans le commerce. On reviendra sur ce point. Le milieu dans lequel évolue le héros serait cauchemardesque, tragique même, si le cadre sordide et les mauvais traitements l’avaient rendu méchant et vindicatif. Mais ce n’est pas le cas ; l’orphelin s’arrange pour conserver sa bonne humeur malgré tout et, sans aller jusqu’à pardonner formellement[15] à ceux qui l’ont cruellement tourmenté dans son enfance et sa jeunesse, il n’exprime jamais ouvertement de haine pour eux.
L’auteur décrit sans la moindre indulgence la malpropreté physique qui régnait de manière quasi-universelle dans certains lieux de Paris et parmi certaines couches de la population et qui correspond bien ici à la méchanceté de sa demi-sœur, de son beau-frère et d’autres parents. Nous avons en particulier des descriptions assez saisissantes de la saleté repoussante de certains intérieurs, encore qu’il passe sous silence la « crotte » qui infectait rues et places, et dont certains historiens nous ont laissé une idée assez précise. Comme on l’a dit plus haut, cette malpropreté est concomitante avec les souffrances physiques et morales qu’endure l’orphelin de la part de sa parenté et de ceux qui sont chargés de son éducation : coups, brimades, privations, voire même la maladie et les accidents graves sont son lot quasi-quotidien. Et pourtant, l’auteur précise dans l’avertissement « Au lecteur » :
Mais avec tous les désordres et fâcheux inconvénients qu’il a soutenus, s’étant même trouvé engagé contre son inclination en la fréquentation de plusieurs sortes de gens selon les rencontres, il n’a jamais fait aucune action qui ait pu ternir l’honneur de sa naissance, dont je suis obligé rendre témoignage en sa faveur, avertissant aussi de sa part le lecteur que cette histoire, où est fait un mélange du sérieux et du plaisant, ne lui est pas seulement donnée pour s’en divertir, mais pour en profiter si bon lui semble, sa principale intention étant de blâmer les vices et enseigner moyen de les éviter plutôt que celui de les mettre en usage (4).
L’intention didactique semble ici de convention, mais ce qui est important, c’est le pouvoir d’observation que manifeste l’auteur. Pour être à même d’exprimer, de verbaliser son observation du monde et des instances de désir qu’il y observe, le picaro doit lui-même refuser de s’investir dans le désir afin de conserver la lucidité nécessaire à sa narration. Autrement, il cesse de parler du monde pour ne parler que de lui-même. Paradoxe : tout en racontant à la première personne, le je parle de tout sauf du je[16], c’est-à-dire de ses propres pensées, émotions et sentiments.
Notons qu’en dépit de l’explicit du roman, qui est de l’auteur plutôt que du narrateur, l’orphelin se montre neutre : ni antireligieux, ni fervent. On donne ci-dessous pour information les dernières paroles de Préfontaine, qu’il ne faut pas attribuer à l’orphelin (noter le discours à la troisième personne) :
L’emploi où présentement il s’occupe[17] et l’estime qu’il tâche de s’acquérir parmi les grands lui fait espérer que la mauvaise fortune se lasse de le traverser, mais comme nous devons tout remettre entre les mains de cette divine Providence, qui est inconnue aux hommes, dont la plus sage conduite n’est pas toujours la maîtresse des événements, s’il lui arrivait que, pensant prendre l’occasion aux cheveux, elle fût fardée et que s’échappant elle lui laissa seulement sa perruque, il s’en faudrait consoler ainsi que de tout le passé, dont je finirai ici le discours en disant pour l’avenir, comme les astrologues, Dieu sur tout (143).
Libertin ou non, il demeure cependant difficile de nier les aspects les plus importants de la psychologie du héros, qui demeure libre de corruption morale en dépit de ses fréquentations, qui vont de sa famille cruelle aux prostituées et voleurs du Paris de Louis XIII, présenté comme une dystopie pour l’orphelin. Est-ce parce qu’il est un être de haute vertu, ou plutôt parce que faire autrement, c’est s’investir dans le désir et perdre par là son pouvoir verbalisateur ?
Si les mauvais traitements lui viennent surtout de sa famille, les filous et les prostituées, ainsi que les fils de famille dévoyés, avides de s’encanailler dans ce milieu interlope, et qui forment le plus clair de sa compagnie, sont, paradoxalement, plus supportables, lui offrant des occasions de manger et surtout de boire. Remis des graves blessures qu’il avait souffertes en se portant au secours de deux religieux maltraités par des ivrognes (117), l’orphelin se voit à nouveau dans le dénuement et obligé de vivre d’expédients. Tout en étant réduit à fréquenter la racaille, il ne manque pas de préciser :
Puis, ne sachant de quel bois faire flèche, il me fallut continuer à vivre d’invention. Je me remis à chercher l’occasion et à hanter toutes sortes de gens, m’empêchant pourtant de faire aucune action qui me pût apporter du déshonneur[18] car pour le reste, ma vie était souvent à la pointe de l’épée qui, ne ressemblant point à ceux qui ont pris médecine, n’appréhendait point l’air. (121)
Il faut d’abord noter qu’il considère, comme on l’a dit, les plus basses classes de la société comme plus charitables ou du moins plus bienveillantes que sa propre parenté. Durant sa maladie et sa convalescence, sa demi-sœur ne lui avait pas apporté le moindre secours. Ensuite, on constate que, bien que menant (par nécessité) une vie de gueux, il porte néanmoins une épée (réservée aux nobles en principe), dont il s’était servi pour venir au secours des moines —sans succès, puisqu’il avait été mis à mal lui-même. L’auteur mêle ainsi habilement réalité et métaphore, puisque l’expression « à la pointe de l’épée » signifie « difficilement, par le moyen d’expédients ». On trouve cette expression dans la fable de La Fontaine Le Loup et le Chien (Livre I, vv. 19–20). Le chien rappelle au loup sa condition précaire ; trouver à manger est toujours problématique :
Car quoi ? rien d’assuré : point de franche lippée
Tout à la pointe de l’épée.
C’est précisément le lot de l’orphelin, pour qui chaque repas, chaque verre de vin constitue un obstacle à surmonter, et dont il ne triomphe souvent que dans la compagnie des marginaux.
Filous et prostituées vont de pair. Ce n’est pas gratuitement que Préfontaine présente celles-ci au lecteur. L’orphelin note qu’elles sont renfermées dans ce qu’il appelle un banc à coucher[19], meuble qu’il reconnaît (en dépit de sa décrépitude) comme celui où il couchait lui-même lorsqu’il avait été mis chez le maître à écrire, dans sa jeunesse (infra).
Loin de porter un jugement moral sur ces « classes criminelles », il dépeint les prostituées non comme de mauvaises femmes, mais comme de pauvres filles à la merci à la fois de leur maquerelle et de la police[20]. Les artifices auxquels elles ont recours pour aguicher le client inspirent la pitié plutôt que la luxure. L’emprisonnement de l’une d’entre elles donnera lieu à une chanson, vraisemblablement composée, comme une ou deux autres dans l’ouvrage, par l’auteur lui-même, et qu’on pourrait intituler Les Putains-s’en-vont-en-guerre :
La Repaire, au désespoir,
De ce qu’on l’a mise en cage,
Jure qu’elle fera voir
Que ses gens ont du courage,
Qu’elle fera rallier
La plupart de son gibier
Pour faire une compagnie
Des filles de l’industrie.
La Haynaut lui a promis
Faire plusieurs compagnies,
Des putains du temps jadis,
Qui sont ses bonnes amies.
Elle prendra la Franchon,
La Saint-Arnou, la Nanon,
La Charpentier, la Normande,
La du Bois et la Flamande.
Louison et la Canadas
Passeront pour volontaires.
La Hubert, la Saint-Thomas
Ne demeurent pas derrière.
La du Verger, la Forêts
Disent qu’elles iront après
Pour achever ce voyage :
Ce sont mules de bagage. (123–124)
Comme l’on peut voir, cette chanson (dont le texte original ne donne pas la musique) reflète à la fois une certaine verve populaire et fournit un aperçu sociologique —si mince soit-il— des attitudes des prostituées, qui de toute évidence ne se laissaient pas faire par les forces de l’ordre sans regimber ; les noms ou sobriquets que mentionne l’auteur correspondraient peut-être à des personnes ayant réellement vécu, si l’on s’en tient à ce que dit la notice du Dictionnaire des Lettres françaises sur son mode de vie[21]. Si tant est qu’on puisse parler de libertinage dans ce roman, celui de l’orphelin se borne à décrire la corruption morale qui l’entoure, sans porter de jugement dessus et sans s’y immiscer lui-même, ce qui lui permet de demeurer libre d’observer cet environnement et de le commenter.
Sans vouloir présenter L’Orphelin infortuné comme un ouvrage sur l’anthropologie de la délinquance au XVIIe siècle, il est quand même intéressant de noter les exemples et les variations de criminalité (outre la prostitution) que cite l’auteur. Depuis les voleurs de paquets et de paniers qui guettent les provinciaux au débarqué des bateaux ou à l’arrivée des coches jusqu’aux fausses servantes qui, un tison éteint à la main, font semblant de chercher du feu pour s’introduire dans les maisons et les dévaliser, en passant par la femme prétendument enceinte qui va avec une compagne chez une sage-femme pour se faire examiner pendant que la complice fait main basse sur tout ce qu’elle peut, Préfontaine offre un échantillonnage instructif sur les pratiques crapuleuses de l’époque (124–126), sciemment juxtaposé à l’aperçu précédent sur les pratiques de prostitution. Il demeure cependant muet sur les meurtres qui devaient se produire régulièrement, surtout à la faveur de la nuit, dans les quartiers mal famés de Paris. Pour cela, on peut consulter l’Histoire générale des larrons, de François de Calvi[22].
La corruption, la cruauté, l’avarice vont de pair avec les conditions physiques de malpropreté, dans lesquelles évolue le personnage principal (et les autres aussi, bien sûr…). Inutile de chercher une attitude philosophique : Préfontaine semble éviter sciemment de présenter de quelconques personnages qui puissent faire pendant, soit à l’orphelin, soit aux autres qui peuplent le roman, pour formuler une idéologie qui transcende le sordide quotidien, ce qui tendrait à confirmer le manque d’intention didactique véritable (supra).
Pour l’auteur la malpropreté physique de l’environnement où fonctionne son protagoniste va de soi, c’est pourquoi sans doute il n’en parle pas en détail, ce qui est peut-être une lacune, mais permet d’autre part au lecteur contemporain d’exercer son imagination. On peut aussi se reporter à Furetière, qui un peu plus explicite sur la condition répugnante des rues dans Le Roman Bourgeois (925–927), sorti 6 ans après L’Orphelin infortuné. Mais Furetière ne manifeste aucune velléité de promouvoir l’hygiène publique : ses allusions sont là surtout pour mettre en relief le ridicule du Marquis. C’est pourquoi on doit avoir recours à des sources historiques plutôt que littéraires contemporaines.
On commencera par parler de ces conditions d’hygiène, au double point de vue personnel et urbain. Dans Le Propre et le sale (q.v.), Georges Vigarello met à l’origine de l’abstention de bains et de ses conséquences les épidémies de peste qui sévissaient en Europe aux XVIe et XVIIe siècles (15–16). Sous l’influence des médecins, les pouvoirs publics interdisent l’usage des étuves (bains publics), établies en grand nombre dans les villes principales depuis le XIIe siècle, selon l’article de Monique Closson (1). Pourquoi ? Parce que, selon la Faculté, l’eau chaude dilate les pores et facilite l’entrée de l’air infecté de peste dans le corps. Vigarello note que, tout en reconnaissant la valeur curative des stations thermales, chose acceptée depuis les Romains, aux XVIe et XVIIe siècles les autorités médicales affirment que l’eau combinée avec la chaleur ouvre le corps à l’invasion de toutes sortes de pathologies, outre la peste (19). Ajoutons que l’Église favorisait elle aussi la fermeture de ces étuves, à cause de la promiscuité sexuelle et de la prostitution qui y régnaient depuis le Moyen Âge.
On peut trouver dans L’Orphelin infortuné deux petits épisodes qui renseignent assez bien le lecteur sur la pratique assez commune de vider les pots de chambre par la fenêtre. Tous deux, au chapitre XIII, mêlent de façon assez révoltante l’amour et l’excrément. Le premier affecte l’orphelin lui-même, qui va soupirer sous les fenêtres d’Aurore, la sœur de son ami, pour laquelle il a conçu (pour la première et la seule fois de sa vie), un véritable amour. Malheureusement, voici comment se solde cette aventure :
Un soir entre autres, ces gens[23], ayant assurément fait excrémenter chez eux tous ceux de leur connaissance, prirent l’occasion juste de me faire avec ce puant amas non seulement un bonnet de merde, mais l’habillement complet, dans l’espace de deux rues, où je ne puis croire que je ne fusse guetté. (77)
Ce n’est pas seulement une fois, mais sept qu’il se voit la cible de pareils projectiles. Cela indique que c’est la nuit qu’on déversait systématiquement par les fenêtres le contenu des pots de chambre et autres ordures. L’orphelin, c’est le cas de le dire ici, est vraiment infortuné.
Le deuxième consiste en un petit poème qui se veut galant, composé par un ami du héros et dédié à sa belle à lui, et dont voici les deuxième et troisième strophes :
Hier au soir marchant à tâtons[24]
Comme un aveugle sans bâton,
J’arrivai auprès de ta porte
Où une sorcière à sabbat,
Emplit ma tête et mon rabat
D’une puante bourguignotte[25].
Je quittai aussitôt l’amour
Et sans attendre qu’il fût jour
Je retournai dans ma tanière,
Où me fallut changer d’habit,
Donnant au diable le déduit,
La maison et la chambrière. (78–79)
Pour avoir une idée plus générale, cependant, de l’état des rues de Paris sous Louis XIII, il faut se tourner vers l’ouvrage d’Émile Magne sur la vie quotidienne au temps de ce monarque (q.v.) pour se figurer ce que les Parisiens devaient endurer à cette époque. En dépit des efforts du roi pour assainir les rues[26], elles restent immondes. Relevons ce passage :
La puanteur subsiste. La boue ou, pour parler comme les gens du siècle, la « crotte », englue vite le pavé nouvellement posé qui disparaît bientôt sous elle. Elle résiste au balayage et au lavage. Subtil mélange de crottins laissés sur la chaussée par les chevaux, ânes, mulets, bestiaux qui y circulent par myriades, de fumiers débordant des caves et des écuries, de gravois[27] sortis des ateliers et chantiers de construction, de détritus végétaux jetés au hasard par les herbagers forains, de résidus organiques expulsés des écorcheries, tueries et tanneries, le tout pétri sous les roues d’innombrables véhicules, avec la fange des ruisseaux où croupissent les déjections des éviers et des latrines, elle forme, au dire des contemporains, une « moutarde » noirâtre de senteur à la fois cadavérique et sulfureuse, piquante aux narines (24–25).
Roland Mousnier dans son histoire de la capitale (q.v.) observe que cette saleté généralisée nuisait même au commerce et donc au fonctionnement économique de la capitale, qui comptait sur ses différents ports fluviaux pour la plupart des denrées alimentaires consommées par les Parisiens : « En effet [dit-il], les bords de la Seine étaient envasés, remplis d’immondices » (195), ce qui gênait l’abordage des bateaux amenant les denrées alimentaires dans la capitale.
Cent ans plus tard, les choses n’ont pas vraiment changé, comme on peut s’en rendre compte à la lecture du roman de Patrick Süskind Le Parfum (q.v.). L’auteur laisse une description olfactive saisissante du Paris de 1738, donnée ici à titre d’indication, pour confirmer ce que dit Émile Magne du Paris d’un siècle auparavant. Description romancée bien sûr, mais à la lecture de l’ouvrage, on voit que Süskind s’est bien documenté :
A l’époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l’urine, les cages d’escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton; les pièces d’habitation mal aérées puaient la poussière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtepointes moites et le remugle âcre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre. Les tanneries la puanteur de leurs bains corrosifs, et les abattoirs la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés; leurs bouches puaient les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d’oignons, et leurs corps, dès qu’ils n’étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l’épouse de son maître artisan, la noblesse puait du haut jusqu’en bas, et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve et la reine comme une vieille chèvre. Été comme hiver. Car en ce XVIIIe siècle, l’activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite, aussi n’y avait-il aucune activité humaine, qu’elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien à son déclin, qui ne fût accompagnée de puanteur (9–10).Il faut noter toutefois que Louis-Sébastien Mercier peint une image fort différente dans son Tableau de Paris (1781), versant olfactif en moins (sauf pour les cheminées). Poétiquement, il dote la capitale de toutes sortes d’attraits dont Magne, Mousnier, Süskind font abstraction. Mais en fait sa description, qui présente le Paris de la fin du XVIIIe siècle, est assez idéalisée pour qu’on puisse dire qu’elle n’est pas très réaliste.
Pour en revenir à L’Orphelin infortuné, c’est au chapitre III que le lecteur est confronté explicitement pour la première fois dans le roman à la malpropreté physique qui entoure le héros. Ayant été mis en pension chez un maître à écrire de la plus basse classe possible, il décrit ainsi la chambre où il va coucher :
Il y avait avec lui [le maître à écrire chez qui il est mis en pension] une bonne vieille femme qui était sa mère. Il lui donna ordre de me faire coucher et elle me montra le lit qu’on m’avait préparé, qui était une invention faite comme une paire d’armoires, que l’on appelle un banc à coucher, puis elle se retira en un méchant grabat, derrière un morceau de natte volante pendue au plancher[28], qui séparait son alcôve d’avec l’appartement de Monsieur son fils, qui était une chambre du quatrième étage, tapissée d’araignées[29] en quelques endroits et en d’autres de vieux crachats, à qui le temps avait fait prendre diverses figures (15).
Le roman mentionne également que le logement de ce maître à écrire était si enfumé qu’il l’appelle renardière, c’est-à-dire une tanière de renard[30], sans doute à cause de cheminées tirant mal. Le décor et l’ameublement sordides contrastent avec ce que nous apprend Émile Magne, qui consacre une partie du chapitre IV de son ouvrage au décor et à l’ameublement de la maison bourgeoise et aristocratique à Paris[31]. Ce qu’il ne mentionne pas, c’est l’état ordinaire de propreté des lieux. Il ne nous est donc pas possible de porter un jugement sur ce point à partir de données historiques, contrairement à l’état des rues. On peut supposer que les logements des classes plus aisées ou aristocratiques étaient balayés plus ou moins régulièrement, ce qui ne semble même pas être le cas ici. Le texte fait mention d’un balai qui a beaucoup servi et que le beau-frère du héros éponyme emploie pour le battre (11). Mais on peut se rapporter aux citations de Magne et de Süskind pour supposer que la toute petite-bourgeoisie, à plus forte raison les classes ouvrières, était assez peu pointilleuse sur les questions de propreté (voir supra le mur constellé de crachats séchés).
L’avarice peut aussi se considérer comme faisant partie des désordres ou de la malpropreté morale auxquels est exposé l’orphelin. Le narrateur offre un échantillonnage détaillé de celle de l’épouse du maître à écrire de l’orphelin. Que ce soit la viande sur le point de se gâter qu’elle va acheter le jeudi soir à bas prix[32], les tripes mal cuites à dessein pour en limiter la consommation et les poissons qu’elle prépare exprès sans les vider pour qu’on en mange aussi peu que possible, les œufs fêlés et à moitié vides, le lecteur a sous les yeux toute une gamme de pratiques plutôt répugnantes dont le but est de dépenser le moins possible et surtout sur l’orphelin, de façon à économiser au maximum sur sa pension. S’il n’est pas battu chez son maître à écrire, il y est souvent traité en serviteur plutôt qu’en élève et si peu et si mal nourri qu’il est obligé de faire de menus travaux dans le voisinage afin de se payer de quoi manger (25).
Ouvrons ici une parenthèse pour parler de l’innovation narrative et descriptive qui marque L’Orphelin infortuné. Pour cela, il faut se rapporter à l’archétype des histoires comiques, c’est-à-dire l’Histoire comique de Francion (1623). Dans le Troisième Livre, nous faisons connaissance avec le pédant Hortensius, dont Sorel présente de façon comique la ridicule prétention. Il est aussi parcimonieux que la femme du maître à écrire de l’orphelin, rognant au possible sur les frais de nourriture de ses élèves et s’attirant par là toutes sortes de tours de la part de ceux-ci, spécialement Francion (171–180). Ce qui distingue L’Orphelin infortuné du Francion, toutefois, c’est le degré extrême d’avarice de la femme du maître et le récit aussi sordide que détaillé que donne l’auteur de la manière dont elle s’y prend pour soit nourrir au moindre coût soit même carrément affamer non seulement le héros, mais aussi la petite servante qu’elle a fait venir de la campagne et qu’elle traite au moins aussi mal que son pensionnaire (19). L’âpreté au gain de la femme du maître dépasse de loin la pingrerie somme toute assez comique d’Hortensius. Contrairement au pédant du Francion, qui pourrait passer pour avoir des préoccupations intellectuelles, elle est totalement terre-à-terre, n’ayant en vue que son commerce (elle est marchande de bois à brûler) et l’obsession, voire l’acharnement, de dépenser le moins possible, choses que Préfontaine rapporte avec assez de détail pour donner à penser qu’il s’est documenté d’après des situations véritables, faisant ainsi preuve de plus de réalisme que la plupart de ses confrères auteurs d’histoires comiques. Non seulement on ne voit pas cette avarice concentrée, morne et sans joie dans le Francion[33], mais elle est virtuellement absente d’autres histoires comiques, notamment Le Gascon extravagant, d’O. S. de Claireville (1637) et Le Page disgracié, de Tristan (1642)[34]. J. Serroy n’évoque pas non plus ce topos dans Roman et réalité. D’ailleurs, si Sorel —et, à un moindre degré, Tristan— dépeignent l’avarice surtout dans le but d’en faire la satire, Préfontaine, lui, la donne comme faisant partie de la vie quotidienne, sans aucun commentaire social ou moral.
Si l’avarice, surtout à ce point exacerbé, est un vice moral grave, la saleté physique y constitue un parallèle indéniable. On constate au chapitre IX que, de retour chez sa sœur aînée, il retombe malade. La méchante femme le fait mettre dans une chambre dont voici la description :
Ce taudis où l’on m’avait porté était un petit nid à rats, duquel il y avait à un coin deux ou trois pièces de bois scellées dans la muraille qui composaient un lit, avec de la paille tout usée, menue et pourrie de l’humidité d’une gouttière et tout proche il avait une petite fenêtre au-dessus de l’ouverture d’un privé qui n’était jamais bouché et m’envoyait de très désagréables vapeurs. Ce fut donc là le beau logement qui m’était marqué et où j’ai depuis ce temps-là couché plus de deux ans, ce qui m’a causé de grandes fluctions (57).
Il ajoute que les seuls temps où il n’est pas battu sont ceux durant lesquels il est malade, ce qui lui arrive bien souvent, jusque dans l’âge adulte.
Il ne tombe vraiment amoureux qu’une seule fois dans sa vie (Chs. XII–XIII) et encore cet amour est loin d’être payé de retour. Mais même le rôle d’amoureux transi lui est refusé. On a parlé plus haut de la relation entre l’amour et l’excrément à laquelle l’auteur semble vouloir donner l’apparence de cause à effet. Après la première douche excrémentielle qu’il subit (supra), une deuxième achève de décourager ses entreprises amoureuses :
Mais ce fut bien pis quand, proche de cette maison dont souvent je me satisfaisais de contempler les dehors, je me sentis accablé non de la vidange d’un bassin à chaire percée, mais je crois d’une cuve entière de toutes sortes de puanteurs parmi lesquelles il y avait quantité de morceaux de verre et de bouteilles cassées, qui me pensèrent diffamer le visage (77).
Ses déboires sont loin de s’arrêter là. On pourrait penser que son arrivée à l’âge adulte (25 ans) annoncerait la fin de ses malheurs (Ch. XV). Les deux événements qui normalement signifient prospérité et bonheur, c’est-à-dire sa réception dans la corporation des marchands et son mariage sont au contraire un tremplin qui fait rebondir ses malheurs. Sa parenté l’exploite et finit par le mener à la ruine. Quant à la femme qu’il épouse, voici ce qu’il en dit :
Après que j’eus été quelque temps en boutique, je songeai, mais à la male heure et trop tôt pour moi, à me marier. Il se rencontra des occasions avantageuses que mes parents, qui avaient dessein de me voir un jour gueux, détournèrent par leur médisance, mais ils ne s’opposèrent nullement à celle qui fut la cause de ma ruine car j’épousai une fille qui, ayant été mal élevée avec un beau-père avare, grand chicaneur et mal accommodé de biens et une mère qui avait l’esprit comme aliéné, se trouva si mal moriginée[35], qu’elle me donna beaucoup de peine. Elle n’avait aucun sens ni raison et n’en voulait point écouter. Nous avions souvent bruit pour sa grossièreté de langage et elle me disait qu’elle ne voulait pas être gromandée et passer pour ma vassarde, au lieu de dire gourmandée et vassale. Je lui dis une fois qu’elle assommait Ronsard. Elle me répondit qu’elle se moquait de Ronflard, que Ronflard ne lui donnait pas à déneret que je la voulais mettre aux cendres de la terre, pour dire le centre. Enfin au lieu du sommet de la tête, elle voulait que ce fût le sommeil, à cause que quand elle s’endormait, sa tête, disait-elle, se trouvait appesantie (96).
Non seulement elle est sotte et inculte, mais aussi acariâtre et querelleuse, vivant en mauvaise entente perpétuelle avec son mari et une demi-sœur de celui-ci qu’il a recueillie. Cette famille ne durera pas longtemps, le fils que lui donne sa femme étant emporté par la petite vérole à l’âge de onze mois et la femme elle-même peu après, par l’hydropisie. Cette mort achève de le ruiner.
Il faut noter en passant que cette déformation grotesque de Ronsard en Ronflard est bien la seule référence qui puisse passer pour littéraire dans tout le texte, même si l’allusion implique qu’il ait connaissance de l’œuvre du poète et qu’il en ait fait mention à sa femme. Nulle part ailleurs il n’est fait mention de lui ou de toute autre figure littéraire. Le lien avec la bourgeoisie lettrée que lui attribue Serroy est non seulement, comme on l’a dit plus haut, ténu jusqu’à l’inexistence, mais l’orphelin n’en manifeste aucune conscience, à moins que l’on veuille arguer que son refus de s’encanailler ne soit dû à cette conscience de classe. Malheureusement, il n’existe aucune preuve textuelle de cela.
La malpropreté au physique et au moral, toujours présentes, font de l’environnement urbain une espèce de Cour des Miracles, notamment au chapitre XVII, où l’orphelin loge, après la ruine de son commerce, dans un immonde galetas en compagnie de trois anciens soldats n’ayant qu’un bras à eux trois et manquant d’un certain nombre de jambes, et qu’il nomme par dérision « demi-chrétiens » (114–115).
Pour sortir de ce lieu insupportable, il cherche à se renflouer en mettant à profit ses connaissances en écriture au Palais de justice. Cette tentative n’aboutit pas (127). On peut la considérer à la fois comme un rappel de son ascendance et une nouvelle marque de la dégradation de sa vie par rapport à celle de son père : le fils de l’homme de lettres ne réussit même pas à être écrivain public ! En fait, même si l’on considère que ce métier pourrait à la rigueur constituer un tremplin —quelque humble qu’il soit— vers l’accès à un statut bourgeois —quelque inférieur qu’il soit— l’orphelin n’arrive pas à amasser assez d’argent pour pouvoir s’élever au-dessus des nécessités quotidiennes de la survie, en butte comme il l’est —ainsi que beaucoup de ses semblables— à l’hostilité des confrères plus anciens, qui veillent jalousement sur leurs privilèges et ne laissent aux plus jeunes que les miettes.
Après cette nouvelle déconfiture, il va connaître bien d’autres péripéties, dont un voyage en Allemagne via les Provinces-Unies pour recueillir la succession d’un frère défunt[36], avant de se caser définitivement comme maître d’hôtel chez un noble parisien et se mariera pour la deuxième fois, sans amour ni joie (ni sans doute plaisir non plus), mais du moins la relation semble stable[37]. Reprenant la parole à la fin de l’ouvrage, l’auteur met (ou remet) en relief l’honnêteté foncière de l’orphelin :
Et après tout, supposez que ce soit l’histoire d’un particulier, vous trouverez que ses misères étaient capables de le porter à d’étranges extrémités s’il n’avait eu beaucoup de retenue, dont il doit rendre de particulières grâces à Celui qui distribue le don des vertus (142–143).
Du XIXe siècle jusque bien avant dans le XXe, L’Orphelin infortuné fut considéré par certains critiques comme de la sous-littérature ou même de la non-littérature, comme il l’a sans doute été du temps de sa parution. Et, il faut bien reconnaître, le texte présente de nombreuses lacunes et d’inexplicables raccourcis, tout en s’appesantissant sur certains détails somme toute assez banals et qui n’ajoutent pas grand-chose à l’intérêt du texte. Pourtant, si l’on veut se faire une idée de la vie d’un individu des classes inférieures de la société, comme de son environnement physique sordide, dans les années 1620–1640, on aurait du mal à trouver un récit plus authentique, avec tout son pessimisme et son fatalisme, que celui de Préfontaine.
University of Georgia
Ouvrages cités ou consultés
Assaf, Francis. « Le picaresque dans Le Page disgracié de Tristan l’Hermite » Dix-septième siècle, 1979 (4): 339-47.
Calvi, François de. Histoire générale des larrons. Paris : Thomas de La Ruelle, 1628 & Veuve Rigaud, 1640.
Closson, Monique. « Propre comme au Moyen-Age ». Historama, n° 40, 1987. http://medieval.mrugala.net/Bains/Bains.htm
Dictionnaire des Lettres françaises — XVIIe siècle. Édition entièrement révisée sous la direction de Patrick Dandrey. Paris : Librairie Générale Française (La Pochothèque), 1996.
Furetière, Antoine. Le Roman bourgeois. In Romanciers du XVIIe siècle. Antoine Adam, éd. Paris : Gallimard (Pléiade), 1973.
Magne, Émile. La vie quotidienne au temps de Louis XIII. Paris : Hachette, 1942.
Mercier, Louis-Sébastien. Tableau de Paris (8 tomes). Amsterdam (s.n.), 1782–1783.
Mousnier, Roland. Paris capitale au temps de Richelieu et de Mazarin. Paris : Éditions A. Pédone, 1978.
Préfontaine, César-François Oudin de. L’Orphelin infortuné, ou le portrait du bon frère. Texte établi, présenté et annoté par Francis Assaf. Toulouse : Société de littératures classiques, 1991.
Serroy, Jean. Roman et réalité : les histoires comiques au XVIIe siècle. Paris : Minard, 1981.
Sorel, Charles. Histoire comique de Francion. Pp. 61–527 in Romanciers du XVIIe siècle. Antoine Adam, éd. Paris : Gallimard (Pléiade), 1973.
Süskind, Patrick. Le Parfum : histoire d’un meurtrier. Traduit de l’allemand par Bernard Lortholary. Paris : Librairie Générale Française (Le Livre de Poche), 1993.
Tristan L’Hermite. Le Page disgracié. Texte établi par Jean Serroy. Grenoble : Presses Universitaire de Grenoble, 1981.
Vigarello, Georges. Le Propre et le sale. Paris : Seuil, 1985.
[1]La notice du Dictionnaire des Lettres françaises —XVIIe siècle (1008) donne un titre erroné: Les Avantages… C’est clairement une coquille.
[2] Une remarque au chapitre V précise qu’il est victime d’un accident survenu au cours des réjouissances célébrant la prise de La Rochelle par les armées royales sous la conduite de Louis XIIIet de Richelieu (29 octobre 1628).
[3]Originellement de René Bray, révisée par Emmanuel Bury et Jean Serroy (1008).
[4]Également connu sous le pseudonyme de « Bibliophile Jacob ». Romancier, historien et bibliothécaire.
[5]Serroy ne relève pas la fin en fausse ouverture comme un aspect contribuant au caractère picaresque d’un roman, mais il évoque abondamment d’autres aspects de la narration. Voir citation infra.
[6]Anonyme (attribué par plusieurs critiques à Diego Hurtado de Mendoza — 1503–1575), Burgos 1554.
[7]Préfontaine a fort bien pu connaître le roman, paru en édition bilingue (espagnol-français) à Paris en 1601, chez Nicolas et Pierre Bonfons. A noter que Serroy ne fait pas mention de cette édition.
[8]La référence est de moi.
[9]Préfontaine explicite d’ailleurs cela au chapitre V, en faisant commenter à son héros les privations de nourriture presque quotidiennes qui lui sont infligées (31).
[10]Vida del pícaro Guzmán de Alfarache. Madrid, 1599–1604.
[11] Voir citation infra.
[12] Les italiques sont de moi.
[13] (16 ??–16 ?? — La Chrysolite, ou le Secret des romans —1634)
[14] Si un titre thématique parle du sujet du livre, un (sous)titre rhématique parle de sa forme.
[15]En dépit de l’explicit du roman : « Dieu sur tout » (qui est clairement de l’auteur et non du personnage), ni le héros, ni les autres personnages (y compris les membres du clergé), ne manifestent une inclination religieuse sensible.
[16] Pour éviter d’alourdir le présent texte par une longue digression, je renverrai le lecteur à la section de l’introduction de mon édition s’intitulant « Les règles du je » (Introduction, xx–xxi).
[17]Il est maître d’hôtel d’un grand seigneur parisien.
[18] Les italiques sont de moi.
[19] L’auteur décrit cet objet comme « une paire d’armoires », sans élaborer (15). L’expression ne se trouve pas dans le Dictionnaire universel. Une recherche électronique sur le site du Conservatoire national des Arts et Métiers (www.cnam.fr) n’a rien donné non plus.
[20] Une ordonnance de 1689 signée par Louis XIV punit les prostituées qui se trouveraient en compagnie de soldats en leur fendant le nez et les oreilles.
[21] L’article « prostitution » du Dictionnaire du Grand Siècle (1264–1265) porte surtout sur les efforts de répression et de réhabilitation des prostituées, tout en rapportant —sans donner de détails— les causes de la prostitution au chômage féminin
[22] L’édition de 1640 est plus élaborée que celle de 1628.
[23] Les voisins des parents d’Aurore.
[24]L’ordonnance royale prévoyant l’installation de lanternes aux coins et au milieu de toutes les rues de Paris date du 2 septembre 1667. Voir le site http://www.geopedia.fr/eclairage-public.htmInterrogé le 10 septembre 2012.
[25] Selon le Dictionnaire universel, une bourguignotte est une « arme deffensive pour couvrir la tête d’un homme de guerre» T. I, p. 268 (c’est-à-dire une sorte de casque). Comme on s’en doute, la « bourguignotte » de la chanson est formée d’excréments.
[26] Les rues principales de Paris sont pavées dès 1184, à l’initiative de Philippe-Auguste. Voir http://www.planete-echo.net/CollecteParis/EugenePoubelle.html. Interrogé le 28 décembre 2010.
[27] Gravats.
[28] Plafond.
[29] Toiles d’araignées.
[30] Une façon de prendre les renards était de les enfumer dans leur terrier.
[31] Il s’est documenté à partir d’inventaires de notaires, d’archives et de plans de l’époque.
[32] Les boucheries sont obligatoirement fermées le vendredi.
[33] On relève une remarque en passant sur l’avarice des paysans dans le Sixième livre (272–273) et le personnage de l’avare Du Buisson aux Huitième et Neuvième livres.
[34] Il parle dans la troisième partie d’un « avare libéral », mais c’est surtout un paradoxe.
[35] Élevée.
[36] Nous sommes alors en 1635. Richelieu a signé avec la Hollande un traité d’alliance offensive et défensive contre l’Espagne le 8 février de la même année.
[37] En fait, le texte ne donne aucun détail sur ce mariage : ni sur la cérémonie, ni sur l’épouse, ni sur les raisons qui ont porté le héros à se remarier.